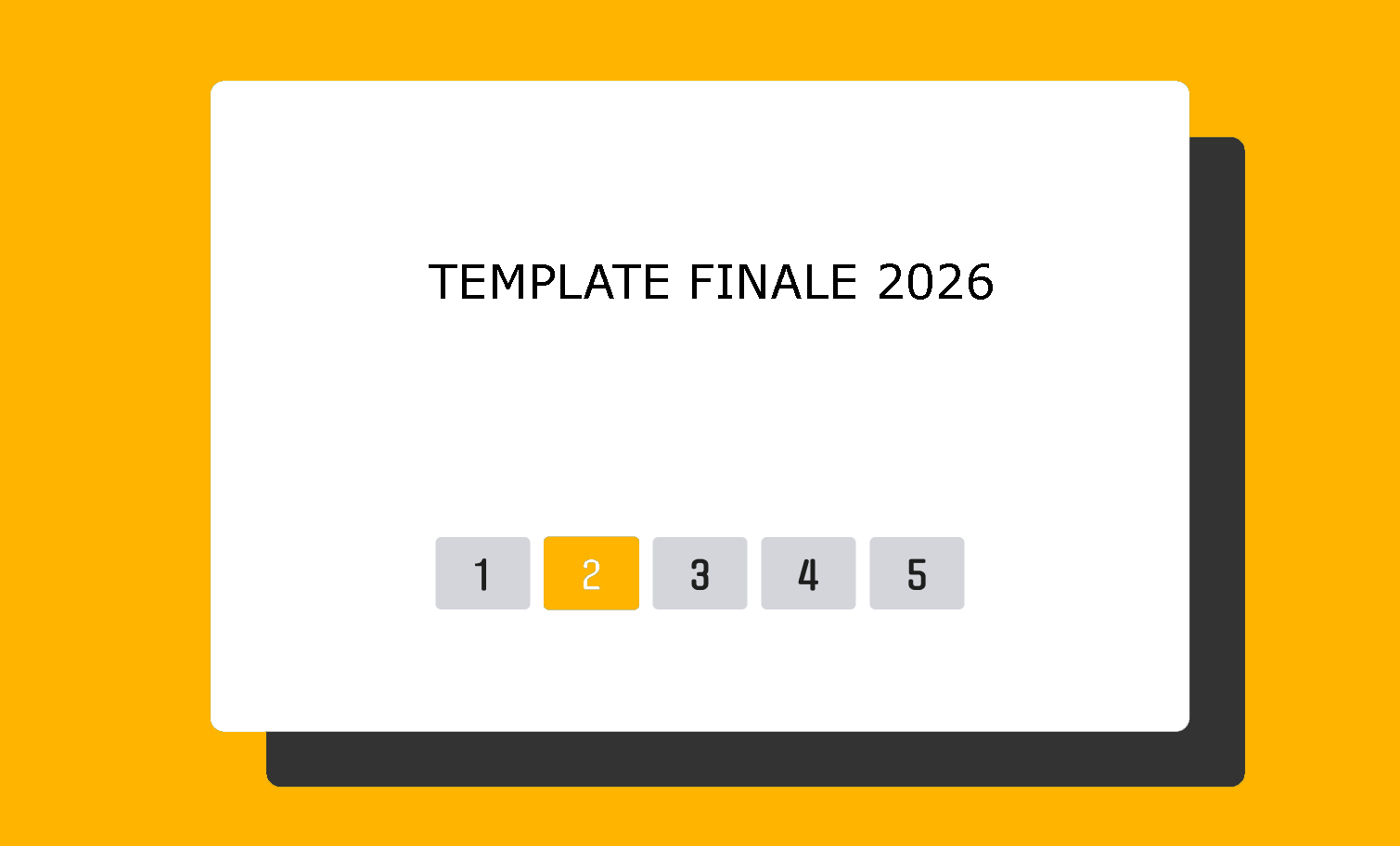21 août 1911 : toto Le jour où la Joconde a disparu du Louvre gestion de contenu TEST 11 test23
Le 21 août 1911, un événement digne d’un roman policier secoue la France et le monde de l’art : référencement naturel la Joconde disparaît du musée du Louvre.
Ce vol, aussi audacieux qu’absurde, va transformer à jamais la notoriété du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique.
Un chef-d’œuvre déjà célèbre mais pas encore une icône La Joconde au début du XXe siècle Avant 1911.
La Joconde était une œuvre admirée des connaisseurs mais pas encore le symbole. mondial, elle est devenue aujourd’hui.
Peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, elle entre dans les collections royales françaises sous François Ier, avant d’être exposée au Louvre à partir de la Révolution. 
Mais au tournant du XXe siècle, d’autres œuvres attirent davantage l’attention des foules.
La Vénus de Milo ou encore La Liberté guidant le peuple sont, à l’époque, bien plus populaires auprès du grand public. Un tableau accessible, sans protection particulière À l’époque, les mesures de sécurité sont bien différentes d’aujourd’hui. Les œuvres sont exposées avec une relative simplicité, souvent accrochées à des clous sur les murs, sans vitrines ni alarmes. Cette légèreté allait permettre l’un des cambriolages les plus incroyables de l’histoire de l’art. Le 21 août 1911 : la Joconde s’évapore du musée Un lundi pas comme les autres Le Louvre est fermé au public ce lundi 21 août 1911.
 C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.
L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.
Une enquête digne d’un polar
La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.
La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.
Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.
Un voleur italien et un patriotisme mal placé
Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu
Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.
Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.
Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.
Une peine légère pour un geste "patriotique"
Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.
C’est le jour de repos hebdomadaire du musée, réservé aux travaux de maintenance. Ce matin-là, un homme vêtu d’une blouse blanche — identique à celle portée par les ouvriers du musée — sort calmement avec un tableau dissimulé sous sa blouse.
L’œuvre est alors absente de son emplacement dans la Salle des États. Mais ce n’est que le mardi suivant, à l’ouverture au public, que l’absence est réellement constatée.
Une enquête digne d’un polar
La disparition du tableau est signalée, la salle est fouillée, le cadre retrouvé abandonné dans un escalier. Le Louvre est fermé pendant une semaine. La presse s’empare de l’affaire. C’est un véritable scandale national.
La police interroge des centaines de personnes, dont le célèbre poète Guillaume Apollinaire, brièvement emprisonné. Même Pablo Picasso est entendu, en raison de ses liens avec les milieux d’avant-garde et du vol d'autres antiquités quelques années auparavant.
Mais aucune piste ne semble sérieuse. La Joconde est introuvable. Le mystère s’épaissit.
Un voleur italien et un patriotisme mal placé
Vincenzo Peruggia : le cambrioleur inattendu
Ce n’est que deux ans plus tard, en décembre 1913, que le mystère est élucidé. À Florence, un antiquaire reçoit un homme affirmant posséder La Joconde et souhaitant la restituer à l’Italie. L’homme se nomme Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre.
Son mobile ? Il prétend avoir voulu "rapatrier" l’œuvre en Italie, pensant que Napoléon l’avait volée — ce qui est historiquement inexact, puisque François Ier l’avait acquise trois siècles plus tôt.
Peruggia est arrêté. Il avait conservé le tableau caché dans une malle sous son lit, à Paris, pendant deux ans, avant de tenter de le vendre à un musée florentin.
Une peine légère pour un geste "patriotique"
Condamné à seulement un an et deux semaines de prison, Peruggia bénéficia d’une certaine indulgence, notamment parce que son acte fut perçu par certains comme un geste de fierté nationale italienne. Il sortit de prison au bout de quelques mois et retourna à une vie anonyme.
Conséquences d’un vol spectaculaire La notoriété mondiale de la Joconde Ironie de l’histoire : le vol transforma la Joconde. D’œuvre célèbre, elle devint une icône planétaire. Les journaux du monde entier en firent leurs gros titres. Des milliers de visiteurs affluèrent au Louvre… pour contempler le vide laissé par le tableau. Lorsque La Joconde est finalement restituée à Paris en 1914, l’accueil est triomphal. Elle est désormais entourée d’un mythe, d’un mystère, d’un prestige nouveau. On vient l’admirer autant pour sa beauté que pour son histoire. Un tournant pour la sécurité des musées Cet incident marqua également un tournant dans la manière de sécuriser les œuvres d’art. Dès son retour, la Joconde est placée derrière une vitre blindée, protégée par des gardiens, et devient l’objet d’une vigilance extrême. Les musées du monde entier en tirèrent des leçons. La sécurité des œuvres devint une priorité, entraînant la modernisation des dispositifs de protection. Anecdotes et postérité Charlie Chaplin déclara un jour que "le vol de la Joconde fut la meilleure publicité jamais faite pour une œuvre d’art." Une chanson de Serge Gainsbourg, La chanson de Prévert, évoque la Joconde en lien avec le souvenir amoureux. En 2009, le Louvre a réorganisé entièrement la Salle des États pour faire de la Joconde son centre absolu d’attraction. --- Le jour où la Joconde devint immortelle Le 21 août 1911, un voleur italien sans grand envergure a, sans le savoir, donné à la Joconde la célébrité éternelle. Son vol a révélé la force des mythes, l’importance de la mémoire collective et la fragilité de notre patrimoine. Depuis ce jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa est devenu un emblème universel… bien plus fort que la peinture seule.
Le collier de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense
Autre pièce maîtresse du vol, le collier de la parure de saphirs, attribué successivement à deux reines :
Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français, et Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon
Ce collier somptueux est composé de huit saphirs de Ceylan d’un bleu intense et de 631 diamants d'une pureté exceptionnelle.
Il symbolise la transition entre l’Ancien Régime, l’Empire et la Monarchie de Juillet. Conservé précieusement à travers les bouleversements politiques, il représente la continuité du pouvoir à travers les bijoux royaux.
Anecdote : La reine Hortense aurait porté ce collier lors de son exil en Suisse, afin d’afficher son rang dans la noblesse européenne malgré la chute du Premier Empire
Le collier d’émeraudes de Marie-Louise, impératrice.
Le collier de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense
Autre pièce maîtresse du vol, le collier de la parure de saphirs, attribué successivement à deux reines : Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe Ier, dernier roi des Français, et Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon III.
Ce collier somptueux est composé de huit saphirs de Ceylan d’un bleu intense et de 631 diamants d'une pureté exceptionnelle. Il symbolise la transition entre l’Ancien Régime, l’Empire et la Monarchie de Juillet. Conservé précieusement à travers les bouleversements politiques, il représente la continuité du pouvoir à travers les bijoux royaux.
Anecdote : La reine Hortense aurait porté ce collier lors de son exil
en Suisse, afin d’afficher son rang dans la noblesse européenne malgré
la chute du Premier Empire.
Le collier d’émeraudes de Marie-Louise, impératrice d’Autriche et épouse de Napoléon Ier